
Ouvrez votre porte à la rencontre
Une fois la protection internationale obtenue, les personnes qui en sont bénéficiaires entrent dans le droit commun (accès au droit de travailler, à la protection sociale, etc.). Elles obtiennent un titre de séjour et vont pouvoir se projeter dans leur nouveau pays.
L’obtention du statut de réfugié ne marque pas la fin de leur parcours migratoire parfois agité. De nombreux obstacles restent à surmonter (apprentissage de la langue et des codes socio-culturels, réalisation du projet professionnel, accès au logement, reconstitution d’un cercle amical, etc.) afin d’accéder à une solution personnelle et professionnelle durable.
Ouvrir sa porte permet de créer des liens (parfois forts, toujours uniques), de partager ses connaissances sur le fonctionnement de notre pays et d'apprendre aux côtés des personnes accueillies (soyons honnêtes, vous allez découvrir des nouvelles recettes de cuisine, entre autres choses). Pour elles, l’accueil est l’occasion de perfectionner la langue au quotidien, et d’appréhender les codes socio-culturels français afin de gagner en confiance et en autonomie.
Pour accueillir, vous avez besoin
01
D'une chambre
Pour accueillir dans de bonnes conditions, il est nécessaire que chacun·e puisse avoir son espace d'intimité. Vous pourrez vous retrouver dans les espaces communs pour passer des moments ensemble.
02
De l'envie d'accueillir
Partager sa maison ou son appartement avec une personne réfugiée c’est faire entrer la vie chez soi ! Une autre culture, d’autres manières de communiquer, une nouvelle gastronomie, etc. Il faut être prêt·e à partager, échanger, expliquer et s’émerveiller.
03
D'un peu de préparation
Pour un accueil réussi, l’équipe vous propose un temps d'échange sur les enjeux de la cohabitation avec des personnes issues de cultures différentes. Cela permet aussi d’aborder l’importance d’une relation d’égal à égal, entre accueillant·e·s et accueilli·e·s. Vous allez donner, mais attendez-vous aussi à beaucoup recevoir !
Comment devenir accueillant·e ?
01
Je m'inscris pour rejoindre la communauté J'accueille
Notre philosophie est de privilégier les vraies rencontres, l’échange et le partage alors pour découvrir l’association et son accompagnement, quoi de mieux que d’en discuter ensemble ?
Remplissez ce formulaire, un·e membre de notre équipe vous contactera rapidement !
Notez que l'inscription est une simple prise de contact et qu'elle est non-engageante.
02
Je participe à un temps d'échange avec un membre de l'équipe
Parler de votre projet d’accueil avec un·e membre de l’équipe mais aussi avec d’autres personnes qui envisagent d’accueillir fait partie des étapes importantes chez J’accueille.
C’est un moment où vous pourrez poser toutes vos questions, notamment à des personnes qui accueillent ou ont déjà accueilli, car elles sont les mieux placées pour vous en parler.
03
Je rencontre la personne que je pourrais accueillir
Après avoir confirmé votre souhait d’accueillir, nos équipes vous mettront en relation avec une personne réfugiée de notre communauté.
Différents critères seront pris en compte pour que la rencontre et l’expérience soit la meilleure : localisation en fonction de l’activité professionnelle de la personne accueillie et intérêts communs (sport, cuisine, musique, etc.) sont parmi les principaux. Dès que vous êtes partant·e·s, la première rencontre peut avoir lieu, à l'extérieur de chez vous pour un maximum de neutralité !
04
Le courant est passé ? L’emménagement peut avoir lieu
Vous vous êtes rencontré·e·s et vous entendez bien ? Vous avez fait visiter la chambre que vous proposez et êtes prêt·e·s à vous lancer ? L’expérience peut commencer !
Du côté de J’accueille, nous prenons de vos nouvelles dès les jours suivant l’emménagement. Nous vous rappellerons régulièrement et vous proposerons des temps collectifs qui vous permettront de rencontrer d’autres accueillant·e·s et accueilli·e·s.
L'équipe J'accueille vous accompagne
Tout au long de l’accueil, nous restons à votre entière disposition pour vous accompagner au mieux.

Un accompagnement social assuré par des professionnel·le·s
En plus de l'accompagnement à la cohabitation, la personne accueillie bénéficie d'un suivi personnalisé avec un·e professionnel·le de l'accompagnement social, visant à faciliter son accès aux droits et à accélérer sa recherche de logement autonome.
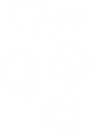
Un accompagnement privilégié de votre cohabitation
Un·e membre de l’équipe locale de l’association est désigné·e comme votre contact référent. Cette personne vous épaulera tout au long de l’accueil, dans les bons comme dans les éventuels moins bons moments.

Une procédure testée et approuvée par 8 années d’expérience
Forts des expériences vécues lors des plus de 1000 cohabitations accompagnées, les procédures et outils développés par nos équipes sont au plus près de vos besoins et encadreront sereinement votre accueil.

Une communauté de personnes qui vous ressemblent
Dans chacun des départements où nous sommes présent·e·s, des rencontres entre accueillant·e·s, accueilli·e·s, membres de la communauté, sont organisées régulièrement pour encourager l’échange et le partage.




